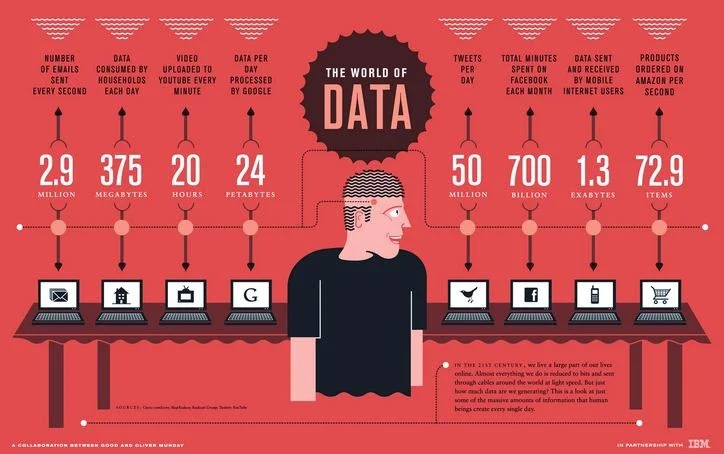L’apnée du
sommeil, peut nécessiter, selon des critères médicaux, la prescription
d’appareils à pression positive continue (PPC), utilisés la nuit pour prévenir
les conséquence néfastes de cette pathologie, notamment la fatigue et les
conséquences cardio-vasculaires. Cela concerne en France environ 400 000
personnes. Ce sont des prestataires privés comme Resmed et Phillips qui
fournissent et entretiennent ces appareils qui sont en partie pris en charge
par la sécurité sociale. Cela coûte cher, notamment en raison des prix
pratiqués par les prestataires, et les bénéficiaires, comme dans toutes les
pathologies chroniques, ne sont pas totalement observants, c'est-à-dire que
certains patients n’utilisent pas leurs appareils ou les utilisent peu. A la suite à
ce constat, des négociations entre les prestataires privés, la direction de
l’assurance maladie, et les services des
ministères de tutelle (Ministres des affaires sociales et de la santé et de l’économie et des
finances) ont abouti en janvier 2014, à la publication d’arrêtés ministériels
conditionnant le remboursement par la sécurité sociale des appareils à
l’obligation pour les bénéficiaires d’accepter la télétransmission en temps réel
de l’utilisation de leurs appareils aux prestataires privés. Le
remboursement d’appareils nécessaires à la santé des bénéficiaires était donc subordonné à la transmission obligatoire de données relevant de la vie intime à
des prestataires privés. Prestataires qui, une fois en possession de ces données, pouvaient en faire ce que bon leur en semblait, par exemple les revendre.
Le décret évoqué dans ce texte a été finalement annulé par
le conseil d’Etat en novembre 2014 au terme d’une bataille juridique engagée
par des associations d’usagers (Fédération des patients insuffisants
respiratoires, FFAIR), parce que
le Conseil d’Etat a jugé que la ministre de la santé n’avait pas compétence
pour prendre une telle décision qui rendait le remboursement du dispositif
médical destiné aux personnes souffrant d’apnée du sommeil tributaire d’une
condition d’observance, ce qui n’était pas prévu par la loi.
Big Data.
Cette affaire posait le problème de la transmission de
données de type médical et relevant de l’intime à des sociétés privées. On est
donc bien dans le domaine du Big Data.
Mais il n’est pas que cela. Il est aussi une nouvelle
menace pesant sur la démocratie.
Face à cette vision très rationnelle, finaliste et claire
de la valeur économique du Big Data, le citoyen moyen en est encore à un état
de naïveté tel qu’on peut le comparer aux indigènes du nouveau monde
face aux colons venus d’Europe, qui échangeant leurs plus grandes richesses
contre des simples verroteries.
Etalage de sa
vie privée sur les réseaux sociaux, participation à des forums santé, le
citoyen passe son temps à fournir des informations personnelles aux sociétés
privées, de manière plus ou moins consciente. Généralement, et de manière
tacite, les plus informés considèrent que livrer sa vie privée est la
contrepartie nécessaire pour bénéficier de différents services fournis par des
sociétés privées, et, notamment, par des multinationales.
Je ne
m’étendrai pas ici sur les aspects juridiques plus techniques parce que je
l’avais déjà fait dans le précédent texte de 2012.
Mon
but est, cette fois, d’apporter quelques informations méconnues du public et
d’alerter sur les enjeux et les risques de cette problématique.
« Libérer
les données », mais au bénéfice de qui ? et pour quoi faire ?
La notion de "donnée de santé" n’est
pas définie juridiquement, ce qui est tout de même assez ennuyeux pour un type d’information objet
d’enjeux économiques aussi massifs et qui se confond dangereusement avec les informations couvertes par
le secret médical, ce qui soulève des questionnements éthiques,
déontologiques et juridiques.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Collectif interassociatif
sur la Santé (CISS) et les associations de consommateurs comme « Que
choisir » ou « 60 millions de consommateurs », ont fait preuve d’une certaine légèreté,
début 2013, lorsqu’ils se sont
associés à des mutuelles, et à une
société privée de traitement des données, Celtipharm, dont je reparlerai plus tard, pour réclamer
l’ouverture à tous ces acteurs des
données contenues dans la base de données de la sécurité sociale appelée SNIIRAM pour système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (LA). Cette base de données regroupe quantité d’informations sur les assurés
rattachés aux différents régimes de base de l’assurance maladie et sur les
patients hospitalisés. Les informations y sont pseudonymisées ICI).
Ce collectif et ces associations ne semblent avoir mesuré
à aucun moment la portée de cette demande, qui faisait donc du droit d’accès à
la base de données publiques contenant des données personnelles protégées par le
secret médical un droit universel, dont auraient dû bénéficier de la même
manière des sociétés privées et des associations ou des acteurs publics.
Les seuls acteurs à se préoccuper vraiment du sujet et à
en mesurer les enjeux, ce sont les ONG oeuvrant dans le domaine des droits de
l’Homme (ICI). En effet, ces ONG savent que lorsque les citoyens deviennent
transparents pour le pouvoir, quel que soit ce pouvoir, il n’y a plus de
démocratie possible. Elles ont entrepris une démarche coordonnée d’analyse de
la situation dans différents pays européens au regard des fichiers de données
informatisés dans les domaines sensibles de la justice, de l’éducation, de la
police et de la santé (voir, en particulier, la monographie concernant la
France).
Mais cette analyse porte essentiellement sur le degré de
protection qu’offrent les législations locales.
Or, très clairement, la pression est telle de la
part des sociétés privées, et, plus particulièrement des grands groupes multinationaux qui ont les moyens d’exploiter les données pour y avoir
accès et se les approprier, que le
problème posé par la gestion des fichiers de données médicales se pose surtout
dans le domaine extra-légal, là où il existe des vides juridiques, des failles
et des possibilités de contourner la loi et ses interdits.
Une protection juridique
très insuffisante du citoyen
La CNIL,
Commission nationale informatique et libertés, a été créée par la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978. Cette commission a pour rôle de
garantir la protection des données personnelles et possède un pouvoir de
sanction financière, toutefois limité.
Néanmoins, en ce qui concerne les données personnelles médicales, il
est évident, lorsqu’on explore les droits et obligations des usagers, que les
obligations pèsent davantage du côté du citoyen, que du côté de ceux qui
recueillent les données informatisées.
Ainsi,
la loi définit que « Selon l’article L 1111-8 du Code de la Santé
Publique, l’hébergement de données de santé à caractère personnel ne peut avoir
lieu qu’après recueil du consentement exprès du patient [cette notion de
consentement exprès, impliquant, en théorie, un consentement écrit, rarement
respecté].
Cependant,
ce consentement n’est pas nécessaire lorsque les professionnels ou établissements
de santé utilisent leur propre système ou des systèmes appartenant à des hébergeurs
agréés dès lors que l’accès aux données est limité aux professionnels ou à l’établissement
de santé qui les a déposées, ainsi qu’à la personne concernée. »
Néanmoins,
le patient n’a pas la possibilité de s’opposer au recueil informatisé de ses
données de santé dans les « fichiers obligatoires » comme celui de la
sécurité sociale, ou le fichier de police, par exemple. Et s’il souhaite s’opposer
au recueil de ses données de santé dans d’autres fichiers, celui de l’hôpital,
celui de la PMI, celui de son médecin… il doit le faire par écrit et "pour des motifs légitimes » (article 38 de la loi
informatique et libertés)". Le titulaire du fichier dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre et peut refuser l’opposition. Pour le DMP, dossier médical personnel, informatisé, en revanche, l’opposition à
sa création ne nécessite pas d’être motivée.
Les
obligations d’information à l’égard du patient de la part de celui qui
recueille les données sont, par contraste, beaucoup plus sommaires. Elles n’apportent
aucune garantie au patient sur les destinataires des données. Bien que la CNIL,
de manière totalement irréaliste,
continue à prétendre, que le médecin reste garant du secret médical (LA) .
Clairement, JE ne peux garantir au patient que des tiers n’auront
pas accès à des informations médicales les concernant que j’aurais mises sur un
réseau informatisé, qui y circuleront de manière parfois non cryptée, pouvant être
accessibles aux détenteurs du système d’exploitation, à des personnels non médicaux,
etc. et qui sont destinées à être conservées pendant plusieurs décennies, ce
qui signifie que leur violation n’est qu’une question de temps. Et je peux encore moins garantir que ces tiers n’en
feront pas usage à l’encontre des intérêts du patient qui s’est confié à moi.
Le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOM), dont une des
missions essentielles est la question relevant de l’éthique et du secret médical,
botte en touche. Dans le bulletin numéro 38 de janvier-février 2015, dans un
dossier concernant la e-santé et les nouvelles technologies, le Dr Patrick
Romestaing, vice-président du Conseil National de l’Ordre, déclare : "la
volonté d’organiser ces think tank au sein de l’institution, contribue à préparer
la profession à ces changements, et surtout à accompagner cette évolution".
Tandis que Jacques Lucas, autre vice-président, nous explique que concernant un
autre domaine, celui des objets connectés, le principe adopté est celui de la
confiance a priori. A savoir qu’on commence par faire confiance, et qu'on constate
les dégâts ensuite.
Des dossiers médicaux
confiés ou vendus à des sociétés privées en Grande-Bretagne et en France :
pas de quoi fouetter un chat ?
En décembre
2011, David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni depuis
2010, déplorait publiquement le gâchis représenté par le fait que les données détenues
par le National Health Service (NHS), service de santé publique
britannique, ne soient pas utilisées. Peu après, a été discuté puis
voté le Health and Social Care Act, entré en vigueur en
avril 2013. Cette loi, entre autres mesures, donna naissance à un nouvel
organisme, le Health and Social Care Information Center (le HSCIC ou
centre d’information sur la santé et la protection sociale). Ce
nouvel organisme, s’est vu investi du pouvoir de collecter des informations de
la part de tous les services publics, mais aussi d’organismes ou de sociétés extérieurs
et de les diffuser à qui bon lui semblait, sans obligation ferme d’anonymisation
de ces données.
Des groupes
de pression et des associations de protection des libertés civiques, se sont
alors regroupés en un collectif pour lutter contre les violations potentielles
de la vie privée induites par cette nouvelle loi, créant le
collectif medConfidential (
ICI)
En février 2014, le journal « The Telegraph » faisait
éclater
un scandale en révélant que
47 millions de dossiers médicaux
hospitaliers, couvrant 13 années entre 1997 et 2010, avaient été vendus par le
NHS à 178 sociétés d’assurances. Ces dossiers avaient été utilisés
par une société d’actuaires (spécialistes du calcul des probabilités pour les
compagnies d’assurance) afin d’affiner le calcul des primes d’assurance en les
croisant avec des informations issues d’une société de crédit qui détenait des
données sur le style de vie de ses clients. Comme le niveau de morbidité des
patients de plus de 50 ans s’était relevé plus élevé que prévu, les compagnies
d’assurances avaient augmenté les primes pour cette catégorie de clients. Cette
affaire survient au moment où le gouvernement britannique envisage la vente des dossiers de
patients suivis par des médecins généralistes (GP). Il prétend que cela améliorerait
les soins aux patients et le taux de survie des cancéreux (
ICI). Cette vente massive de dossiers médicaux aux assureurs était pourtant considérée
comme illégale. L’Associations des Médecins Britanniques(BMA) et le Collège
Royal des médecin Généralistes (RCGP) ont protesté et obtenu la suspension du
programme de collecte de données. Malgré tout, la vente de dossiers s’est
poursuivie en catimini bien qu’ayant été officiellement désavouée. Le directeur
du service public de collecte de données, HSCIC, cité plus haut,
Sir
Nick Partridge,
expliquait que la vente se poursuivrait « seulement à condition que
les assureurs puissent prouver que cela serait au bénéfice de la santé publique et
non dans un but commercial (
LA).
Compte tenu
du fait que l’accord des patients à la collecte informatisée de leurs données
par les médecins généralistes est présumé et ne nécessite pas d’accord
explicite de leur part, le collectif d’associations de défense des libertés
civiques recommande désormais aux patients de remplir un formulaire officiel
demandant à ce que leurs données ne puissent être collectées à partir des réseaux informatiques de leurs médecins
par le HSCIC, afin qu’elles ne puissent être vendues à des tiers (opt-out ou désengagement
des patients du contrat tacite qui permet aux GPs britanniques de communiquer leurs données médicales au service publique de santé, le NHS).
En France,
il faut savoir que des dossiers hospitaliers sont couramment confiés à des
prestataires privés. Ceci afin d’améliorer le codage informatisé car le mauvais
codage des actes est source de perte de revenu pour les hôpitaux, puisque le
financement des hôpitaux se fait selon le système de tarification à l’activité ou
T2A mis en œuvre dans les hôpitaux depuis 2007. Pourtant, le recours à des sociétés
privées pour cette tâche ne correspond pas à un besoin avéré et constitue une
violation du secret médical. Certains médecins, tels
Jean-Jacques
Tanquerel,
se sont
insurgés contre cet état de fait et ont été désavoués par leur hiérarchie (
ICI).
Une société privée travaillant avec
des gros laboratoires pharmaceutiques obtient l’aval du Conseil d’Etat pour
avoir accès aux ordonnances des patients
Une PME française, Celtipharm,
qui avait participé avec des associations de consommateurs et le CISS à
l’action visant à « libérer les données de santé » avait obtenu, en
septembre 2011, l’autorisation de la CNIL pour recueillir auprès de certaines
pharmacies et pour exploiter les ordonnances de patients. Cette société se
décrit ainsi : "Notre métier : Nous inventons,
spécifions et déployons des dispositifs médico-économiques et des plans
d'actions marketing-ventes pour les différents acteurs de
santé." et elle a aussi pour clients de gros laboratoires pharmaceutiques.
La multinationale IMS Health, une société américaine qui est
le plus gros opérateur mondial de données de santé qu’elle revend sous forme
d’études à des organismes publics et privés, s’était opposée à cette décision
et avait présenté un recours devant le Conseil d’Etat. En 2013, une action de
lobbying avait eu lieu à l’Assemblée Nationale en faveur de Celtipharm,
plusieurs parlementaires, tels Jean-Pierre Door, connu pour avoir présidé la
mission d’enquête parlementaire suite à la pseudo-pandémie H1N1, ayant posé en
séance des questions insistantes sur la libération des données au ministre de
la santé (LA). Le 26 mai 2014 le Conseil d’Etat avait rendu une
décision favorable à Celtipharm, l’autorisant donc à recevoir les données issues
des ordonnances d’officine anonymisées par hachage (ICI).
L’anonymisation des dossiers médicaux est un leurre
Le problème, c’est que les spécialistes sont d’accord pour
dire qu’aucun procédé d’anonymisation n’est fiable. Un spécialiste connu et
reconnu de la sécurité informatique, Ross Anderson, professeur à Cambridge,
alertait sur l’impossibilité de protéger les données des dossiers médicaux par
des méthodes d’anonymisation [1]. Un rapport sénatorial avait également établi
et démontré les multiples failles du système (
LA)
.
La désanonymisation des dossiers par des moyens techniques
ne présenterait pas de difficultés majeures. Mais on peut aussi avoir recours à
un procédé de croisement des informations, semblable à celui utilisé dans le
jeu Akinator (
ICI) .
Ce qui revient
à dire que fournir des données médicales personnelles sur les patients à
Celtipharm, qui prétend vouloir faire des études épidémiologiques d’intérêt
général, c’est les fournir aux laboratoires pharmaceutiques qui sont ses
clients.
La loi santé ouvre l’accès de
données de santé et permet le croisement de plusieurs fichiers différents
Le Système national des données
de santé,
SNDS, institué par l’article 47 de la
loi relative à la
santé, va croiser plusieurs registres de
données : le PMSI qui contient toutes les données sur l’hospitalisation
des patients, le SNIIRAM, qui regroupe tout le détail des remboursements, les
données sur les cause de décès des communes, et le système Monaco créé en
partenariat avec les complémentaires qui permet de connaître le reste à charge
des patients (
ICI).
A priori, pour l’instant, l’accès
aux données de santé sera régulé par un comité scientifique, avec comme
critères discriminants principaux, la nature des données selon qu’elles peuvent
être identifiantes ou non, que la demande ait pour objet une recherche
d’intérêt public et que les organismes demandeurs soient ou non à but lucratif.
Les données ne seraient pas, pour l’instant, accessibles aux organismes à but
lucratif. Mais on attend le vote de la loi pour avoir la version définitive de
cet article.
Cela mécontente toute une série
d’acteurs, qui espéraient bien tirer le plus grand profit de l’ouverture des
données, acteurs allant des associations de journalistes aux laboratoires
pharmaceutiques en passant par les mutuelles,
les sociétés d’assurances et le CISS. Mais également l’INDS,
Institut national des données de santé. Pour tous ces acteurs les données de
santé ne seront jamais assez accessibles (
LA). Le lobbying continue.
Un débat dépassé ? Médecine
personnalisée : la grande illusion
Beaucoup espèrent que ce débat
sera bientôt dépassé car ils comptent que ce sera le citoyen qui fournira
lui-même toutes les informations nécessaires pour se transformer en consommateur docile et soumis grâce à
l’asymétrie permise par le contrôle des données individuelles par des sociétés
privées et le marketing one to one. Parmi ceux qui espèrent beaucoup en la
symbiose entre la médecine de précision, ou individuelle, ou personnalisée
d’une part et les objets connectés d’autre part, il y a les laboratoires pharmaceutiques mais aussi les géants
tels qu'Apple ou Google.
Faisons un peu de prospective. Bientôt
ce sera très simple. Chacun se connectera lui-même à des objets de mesure, qui
transmettront instantanément toutes sortes de données à des sociétés privées
spécialisées (peut-être une fusion de Merck et de Google, de plus en plus
impliqué dans le domaine de la santé ?). En effet, Google et Apple
s’avèrent être des acteurs majeurs dans le domaine des objets connectés et
Google investit de plus en plus massivement dans la santé comme le montre la création en 2013 de la
société
Calico, avec, à sa tête
Arthur D Levinson [2] (
LA).
Les objets connectés indiqueront
au patient le moment où ces
mesures dépasseront le seuil de la norme, tel qu’établi par des sociétés
savantes dont les membres seront directement rémunérés, pour faire plus simple,
par les dites sociétés. Ou lui indiqueront qu’il est porteur de tel gène qui
peut potentiellement induire un cancer dans 30 ou 50 ans. Une fois l’anomalie
détectée, les mêmes sociétés lui fourniront les tests adéquats et le traitement
associé (traitement approuvé par la FDA en 24 hs et réputé "sûr et
efficace" --safe and effective). Puis veilleront à ce que ce
traitement soit pris sans faute, en harcelant le patient ou en subordonnant
l’accès à certains droits à la prise régulière du traitement, comme dans le cas de l’apnée du sommeil.
Entretemps, la société d’assurances, qui aura, grâce à cette masse d’informations,
pu individualiser les primes d’assurance, aura été prévenue et augmentera sa prime compte tenu de la
dégradation potentielle de l’état de santé de l’assuré.
Que fera-t-on quand, à la naissance de son enfant, son génome
ayant été décrypté immédiatement, on nous annoncera qu’il est prédestiné à
développer un cancer, puisque la génétique le dit, et qu’il devra prendre tel
traitement toute sa vie pour l’éviter ? Ainsi, le citoyen sera transformé
en patient/client passif n’ayant plus qu’à suivre le parcours fléché tracé par
son fournisseur d’objets connectés. Un patient-consommateur à qui on demandera
de ne surtout jamais exercer son jugement ou faire preuve de discernement, mais
simplement de consommer ce qui lui est proposé, qui lui sera, dans ces
conditions, bien plus nuisible que bénéfique.
Ce monde, pour l’instant,
n’existe que dans les fantasmes des multinationales. Mais son avènement se
produit à une vitesse toujours accéléré et est déjà célébré par les
marchés, les experts les plus en vue du monde scientifique et médical,
ceux-là même qui sont perclus de conflits d’intérêts, les fondations sous
l’emprise de dirigeants de ces mêmes multinationales et les associations de
patients les plus influentes, donnant l’impression qu’il est inéluctable.
La vérité est que la vie et la
santé sont des phénomènes bien trop complexes pour être réduits à quelques
algorithmes, et que la plupart des cancers ne sont pas essentiellement
déterminés par la génétique. Nous devons aussi être conscients du fait que les multinationales ne sont pas les
mieux placées pour prendre soin de notre santé.
Tout ce scénario fait fi du fait
que les progrès dans le domaine des biomédicaments sont encore très très loin
de se traduire en progrès de santé, comme en atteste, notamment l’analyse faite
par Tito Fojo, cancérologue et chercheur au National Center
Institute (voir
LA), qui évalue entre 2,1 et 2,5 mois le gain d’espérance de vie moyen permis par
les nouveaux anticancéreux mis sur le marché par la FDA entre 2000 et 2014 et ceci,
d’après les essais cliniques effectués par les
laboratoires et non dans la vie réelle (
ICI). Ce qui signifie qu’en réalité ces gains pourraient être nuls. Pourtant, si on
se fie à l’analyse de la multinationale IMS Health, les anticancéreux sont la
classe thérapeutique dont le chiffre d’affaires a augmenté le plus rapidement
depuis 2000 et devrait continuer à augmenter de manière exponentielle, en
passant de 36 Milliards de dollars en 2012 à 83 Mds en 2016 (
LA). En 2013, ils étaient au premier rang du chiffre d’affaires
mondial, par classe thérapeutique, avec 67 Mds de dollars de chiffre
d’affaires, donc, probablement, une évolution plus rapide que prévu (
ICI). On peut résumer la situation
autrement :
il existe une déconnexion de plus
en plus marquée entre la proportion de la richesse produite au niveau mondial
captée par les multinationales pharmaceutiques, d’une part, et les bénéfices de
santé induits par leurs produits, d’autre part, mesurés en termes d’amélioration de la santé publique. Ceci est bien illustré par le pays le plus en pointe dans le domaine
des biotechnologies, les Etats-Unis, qui est aussi celui qui présente les
indicateurs de santé publique les plus calamiteux parmi les pays développés,
avec, dans le même temps, des dépenses de santé qui explosent et mettent en
péril tout le système d’assurance santé. Il existe un gouffre entre les progrès
effectués dans le domaine des biotechnologies et leur traduction en termes de
bénéfices de santé que les médias et le marketing s’efforcent de combler
artificiellement en vantant tous les jours les mérites d’une médecine
personnalisée qui n’existe que dans les fantasmes commercialo-scientistes
collectifs comme l’indique clairement le rapport du Sénat sur le sujet (
LA).
Mais l’irruption d’une médecine
personnalisée très coûteuse aux bénéfices inexistants dans notre quotidien pourra
se concrétiser demain, et prendre corps dans la réalité virtuelle du marketing,
grâce aux lacunes du système de contrôle des agences autorisant des mises sur
le marché toujours plus rapides, de médicaments et dispositifs qu’on nous
présentera comme fiables.
Dans un éditorial publié début 2015 par la
FDA, le directeur du service des nouveaux médicaments se flattait d’avoir fait
bénéficier 46% des 41 nouvelles entités moléculaires (nouvelles molécules
jamais utilisées auparavant en médecine, par opposition aux extensions
d’indication des anciennes molécules) soumises à l’approbation de ses services
d’une procédure accélérée, c’est à dire d’une approbation au rabais ne
garantissant ni l’efficacité ni la sécurité de ces molécules (
ICI).
On peut même aller plus
loin et se dire que demain, la « médecine personnalisée » rendra les
essais cliniques caducs. Tout reposera sur la capacité des grands groupes à
persuader chaque patient-client, à travers le marketing personnalisé one to
one, qu’il possède la solution adaptée individuellement pour prévenir le problème
potentiel de santé que ces grands groupes auront eux-mêmes diagnostiqué grâce
aux objets connectés.
Tout cela a bien un sens, mais ce n’est pas celui mis en avant par les médias. Le Big data, la médecine
personnalisée (ou individualisée, ou de précision), seront la voie royale pour
contourner toute forme de régulation collective. Des freins et des verrous
protecteurs, comme la nécessité de tester un médicament selon des règles
précises avant de le proposer aux patients, ou l’interdiction de la publicité
directe aux patients, vont tomber et laisser l’individu seul face à une
formidable puissance marketing assise sur des centaines de milliards de dollars
de chiffres d’affaires.
Contrairement à ce
que disent les associations de patients, les fondations, les experts, ceci
n’est pas un grand espoir mais une redoutable menace. Ce n’est pas l’outil qui
est en cause mais l’impossibilité de le réguler.
Dans ce contexte, la
médiation d’un tiers, le médecin, mais seulement s’il est formé et informé de manière
indépendante, est plus que jamais indispensable pour permettre au patient de ne
pas se laisser piéger par des vaines promesses sans aucun fondement
scientifique.
Notes :
[2] Arthur D. Levinson est à la fois directeur
d’Apple, depuis 2011, succédant à Steve Jobs, directeur de Genentech, biotech
rachetée en 2011 par Hoffmann La Roche, multinationale suisse et deuxième
groupe pharmaceutique mondial par le chiffre d’affaires en 2014 d’après le
classement Fortune et, donc, directeur de Calico, dont l’ambition affichée est
de prolonger la vie jusqu’à 1000 ans. Arthur D Levinson est aussi conseiller
scientifique au Memorial Sloan Kettering center of New York, centre majeur dans
la recherche sur le cancer.